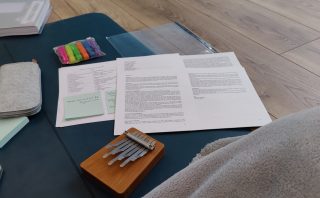Permettre au plus grand nombre de pratiquer le yoga est quelque chose qui m’anime depuis que je suis professeure. Cependant, rendre le yoga accessible n’est pas aussi simple que cela et c’est une manière de voir les choses qui se fait à plusieurs niveaux. Dans cet article, je vous propose d’en discuter et je serai ravie d’avoir votre opinion sur le sujet dans les commentaires.
J’ai divisé mon propos en 3 points et je les ai classés suivant l’évolution de ma vision du yoga accessible. C’est bien évidemment quelque chose qui n’est pas figé ni aussi compartimenté mais je trouvais important de ne pas tout mélanger pour plus de clarté.
Jouer sur le coût
Lorsque j’ai débuté le yoga à Paris, la première chose qui m’a frappée, ce fut le prix des cours. Je venais du monde du fitness (en tant que pratiquante) et j’ai été très surprise par le coût d’un cours de yoga en studio (et à l’époque, ce n’était pas autant qu’aujourd’hui). Même si je comprenais les tarifs (et je les comprends toujours dans une certaine mesure), il était clair que le yoga n’était pas clairement accessible à tous les portemonnaies !
Lorsque j’ai commencé à enseigner, j’ai donc donné des cours à des tarifs plutôt bas et même organisé des cours gratuits. Ce n’était pas un souci car j’avais un CDI à côté qui me permettait de proposer ce type de chose. Ce n’est plus le cas aujourd’hui où je vis à 100% de mon enseignement. Pour continuer à rendre mes cours accessibles pécuniairement parlant, je travaille pour l’association Nour qui a pour objectif d’amener le yoga à des personnes qui n’en ont pas forcément les moyens financiers ou organisationnels et j’anime aussi une chaîne YouTube dont le contenu est entièrement gratuit.
Proposer un maximum d’options
Initialement, j’ai été formé en vinyasa flow, un type de yoga dynamique qui, clairement, n’est pas accessible à tou·te·s. J’ai donc rapidement continué à me former pour pouvoir enseigner autrement et à des populations autres que des jeunes en pleine santé.
Cela me permet de proposer de nombreuses options lorsque j’enseigne afin que chacun·e y trouve son compte : yoga dynamique lent, yoga doux, yoga immobile… mais aussi utilisation variée des accessoires. Mes connaissances en anatomie me permettent également de proposer des cours à des personnes âgées en prenant en compte plus facilement leurs restrictions et en leur proposant des mouvements qui leur conviennent vraiment.
Par ailleurs, dans mes cours, j’invite systématiquement les élèves à reprendre leur pouvoir. C’est leur pratique, pas la mienne et pas celle des autres dans la salle. Il est important de se sentir libre de modifier et / ou de ne pas faire certaines postures si cela ne convient pas (que ce soit pour des raisons physiques ou mentales). Rien ne me fait plus plaisir que de voir des pratiquant·e·s prendre une posture de l’enfant alors que tous les autres élèves continuent à bouger autour. Cela m’amène donc au dernier point de cet article.
Choisir un vocabulaire adapté
Lors de ma première formation, l’emploi du « bon vocabulaire » n’était pas axé sur l’accessibilité mais plutôt sur le fait de porter un propos clair aux élèves pour qu’ils comprennent comment s’installer dans les postures. C’est un point important mais cela ne suffit pas.
Depuis, j’ai suivi plusieurs formations en yoga sensible au trauma (psychique) et je me suis rendue compte que certaines formulations ou certaines propositions faites aux élèves ne sont pas forcément idéales. Les 2 choses qui me viennent à l’esprit en écrivant cela sont : le fait de dire aux élèves de fermer les yeux et ne leur proposer qu’une position allongée sur le dos à la fin du cours.
Désormais, mon langage est tourné vers l’invitation (rien n’est obligatoire) et je propose systématiquement plusieurs options (et pas que pour les postures). Je fais également attention aux images que j’emploie (surtout pour les cours avec Nour où, par exemple, il est inconvenant d’employer des images de relaxation avec les vagues de l’océan à des migrants qui ont traversé la mer Méditerranée sur un bateau). J’enseigne tous mes cours comme si j’avais à faire à des personnes souffrant de trauma psychique (et d’ailleurs lorsqu’on regarde les statistiques des personnes souffrant de problèmes de santé mentale en France, il y a de fortes probabilités pour qu’au moins une personne dans le cours vive ce type de situation).
C’est sûr qu’il n’est pas possible d’éliminer 100% des déclencheurs mais savoir que ça peut arriver et comment y faire face permet aussi de rendre le cours plus sécurisant pour les participant·e·s.
Et après ?
Voilà, je crois que j’ai fait le tour de ce que je voulais vous partager dans cet article. Je serais ravie d’avoir votre point de vue sur le sujet. Si vous cherchez des ressources autour de cette problématique, dites-le moi, je serai ravie de vous en conseiller.
Photo de Samantha Sheppard sur Unsplash